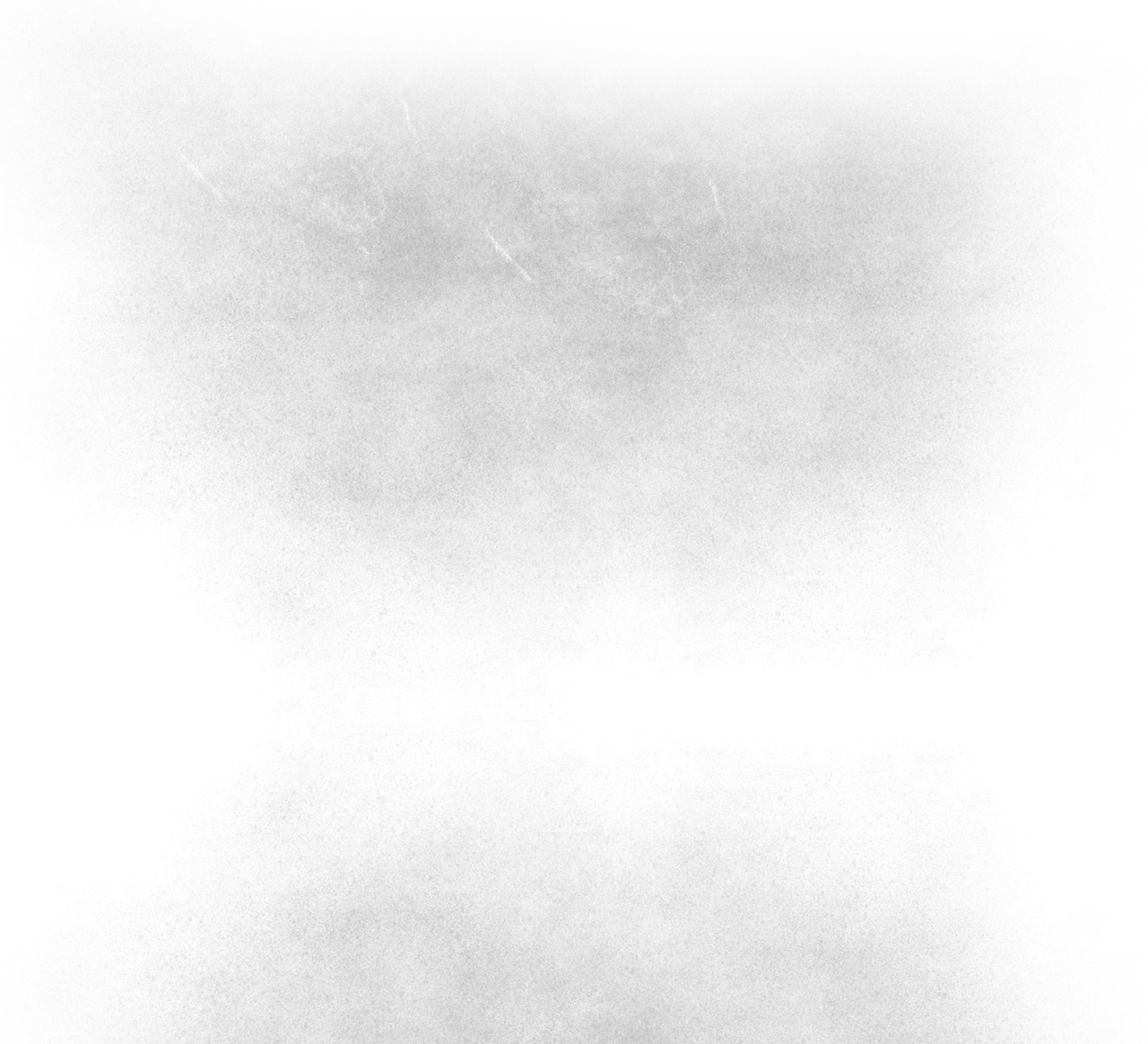
Atari : Game Over
Plongez au coeur de la plus grande légende urbaine du jeu vidéo

Les documentaires sur le jeu vidéo commencent à florir ici et là, bien qu'encore trop peu connus du grand public. Mais cela démontre une chose (s'il y avait encore des sceptiques) : ce secteur est comparable à celui du cinéma, à savoir une industrie juteuse où art et profit se mêlent en ne faisant parfois pas très bon ménage.
Atari : Game Over est un documentaire qui se lit sur plusieurs niveaux.
Il retrace l'histoire d'une des firmes les plus importantes dans l'histoire du jeu vidéo, de sa naissance en 1972, à sa "mort" lors du krach du jeu vidéo de 1983.
Via de nombreux témoignages, qu'il s'agisse de Nolan Bushnell, co-fondateur d'Atari, ou de Howard Scott Warshaw, programmeur à succès, on en apprend énormément sur les débuts d'une industrie, devenue aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de produits culturels.
Un réal' pas comme les autres
Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons un peu du réalisateur. Zak Penn est surtout connu comme scénariste de blockbusters hollywoodiens. C'est à lui que l'on doit notamment Last Action Hero, X-Men 2 ou les Avengers, avec également des films de moindre qualité comme L'incroyable Hulk ou Inspecteur Gadget (ahem... je sais, ça pique).
Il est déjà l'auteur d'un documentaire datant de 2004, Incident at Loch Ness, sorte de documentaire parodique sur Nessie.
Au début du film, Zak retrace rapidement son curriculum vitae, en n'omettant pas de préciser qu'il fut également le scénariste d'adaptations "merdiques" (ses propres termes) de ses films en jeu vidéo.
Mais au-delà de cette certaine dose de recul sur sa carrière, c'est surtout son amour pour les jeux vidéo qui l'a lancé sur ce projet. Etant né en 1968, il a grandi avec les débuts de l'industrie, et affirme être toujours un gamer.

Zak Penn aux manettes.
Mais tout comme son précédent film sur le monstre du Loch Ness, le propos principal du documentaire repose avant tout sur une légende urbaine, plus forte encore que le soi-disant "nude code" pour Tomb Raider. Il s'agit du mythe de l'ensevelissement de millions de cartouches invendues de l'adaptation d'E.T. dans le désert.
Mais avant de revenir sur cette histoire qui agite le petit monde des geeks depuis plusieurs dizaines d'années, plongeons-nous un peu dans l'histoire du jeu vidéo.
Atari, ou le symbole d'une industrie innovante florissante
Dans les années 1970, Atari devient une industrie pionnière et très lucrative en proposant les premiers jeux vidéo jouables sur un poste de télévision, faisant entrer le monde de l'arcade dans les chaumières. C'est un succès quasi immédiat, avec notamment des titres phares comme Pong, Centipede ou Asteroids.
La société engrange des millions et semble inarrêtable.
Le documentaire décide de s'attarder sur la dimension humaine de cette industrie en nous présentant Howard Scott Warshaw, l'une des vedettes du film. Il revient 30 ans plus tard sur le site où il entama sa carrière de développeur chez Atari au début des années 1980, et se remémore avec nostalgie l'ambiance qui régnait alors chez les développeurs.
Malgré (ou grâce ?) aux joints qui tournent dans le studio, à l'alcool qui coule à flots et aux nombreuses fêtes entre développeurs, Warshaw va pondre ce qui va rester comme l'un des plus grands succès de la console Atari 2600 (commercialisée depuis 1977).
C'est avec un shooter intitulé Yar's Revenge, sorti en mai 1982, que Howard va se faire un nom. Il sera même le tout premier développeur à avoir l'autorisation d'entrer son nom dans son jeu, via un easter egg.
Peu de temps après la sortie, on propose à Howard de développer en cinq semaines une adaptation d'E.T., le film à succès de Steven Spielberg sorti un mois après le lancement de Yar's Revenge. Grisé par son succès, il accepte malgré le délai beaucoup trop court de cinq semaines.

Howard Scott Warshaw, programmeur de talent maudit à tout jamais par l'échec retentissant d'E.T.
Quand E.T. se crashe sans pouvoir "téléphoner maison"
Lorsque le jeu sort, au mois de septembre, c'est la bérézina. Considéré comme bien trop difficile et trop éloigné du film, il devient un échec critique et commercial retentissant au vu des prédictions d'Atari. Cet échec s'accentue avec les nombreuses personnes demandant un remboursement de leur achat.
Atari s'effondre peu de temps après, accumulant 536 millions de dollars de pertes en 1983, et la mort de l'entreprise sera synonyme du krack du jeu vidéo survenu la même année. A l'époque, beaucoup estimèrent que cette nouvelle industrie, qui avait connu une fulgurante ascension, venait de rendre l'âme à tout jamais.
Au milieu de ce désastre naquit une légende. Il se raconta que face à tous les invendus, Atari décida d'enterrer, de nuit, des millions de cartouches d'E.T. dans une décharge en plein désert du Nouveau-Mexique.
L'entreprise n'a jamais communiqué sur ce fait, ce qui alimenta la rumeur.
Les années passant, la légende noire d'E.T. va enfler, devenant LE pire jeu vidéo du monde, et à qui on adossera la paternité du krack de 1983.
Et c'est un Howard Scott Warshaw désabusé qui explique, 30 ans plus tard, qu'il a dû abandonner un métier qu'il chérissait temps, une vocation dans laquelle il se sentait bon mais où il était désormais blacklisté.

Le site de fouilles de la décharge d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique.
Quand Indiana Jones fait les poubelles
Pour découvrir le fin mot de l'histoire et déterrer la vérité, Zak Penn se tourne vers Joe Lewandowski, ancien exploitant de société de déchetteries dans la région, qui nous est présenté comme un véritable expert en matière de déchêts enfouis.
C'est avec des photos d'archives de 1983 qu'il a triangulé à peu près la position possible du magot.
Nous suivons également les tentatives de blocage d'élus locaux qui s'opposent à ces fouilles pour d'éventuelles conséquences écologiques et sanitaires.
Bref, une vraie épopée d'archéologie moderne, certes pas aussi trépidante que les aventures du Dr. Jones, mais la progression des fouilles tient malgré tout le spectateur en haleine.
Les recherches, à grands coups d'engins de travaux de construction, finissent par attirer du monde, et une foule de geeks, n'hésitant pas à faire des dizaines d'heures de route, commence à s'amasser autour du site.
"Mais alors ?" me demandez-vous, extatiques; "Qu'en est-il ? La légende est-elle vraie ?".
Et bien oui et non.
Des cartouches d'E.T. ont bel et bien été retrouvées, mais il n'y en avait pas des millions, contrairement à la rumeur. De nombreux jeux d'Atari furent exhumés, dont certains succès commerciaux, et seuls 10% sont des jeux E.T..
La vérité est hélas plus simple. Atari a employé une méthode encore utilisée de nos jours par les entreprises en délicatesse. Pour vider les stocks et éviter ainsi de trop forts coûts d'entreposage, la firme américaine a vidé ses entrepôts.
E.T. n'est donc pas ce pire jeu de l'histoire qu'on s'est plu à nous dépeindre durant toutes ces années. Ce n'est pas non plus le responsable de la crise du jeu vidéo ou de la faillite d'Atari. Il n'aura été qu'un bouc émissaire et restera surtout le symbole d'un jeu au délai de développement bien trop court pour plaire à l'agenda des producteurs.
Au travers de cette aventure, le film met en exergue la passion qui unit les joueurs de jeux vidéo et ceux qui les conçoivent. L'histoire touchante et enrichissante de ce pauvre Howard Scott Warshaw en est le plus bel exemple.
Il nous permet surtout de porter un regard neuf sur les débuts de cette industrie, devenue aujourd'hui encore plus florissante qu'à l'époque.
Anecdote : Je me suis "amusé" à jouer à E.T. lors de la rédaction de cette chronique... Et bien, c'est... Comment dire...
Bon, je vous laisse juger via cet émulateur intégré au navigateur internet :
http://www.virtualatari.org/soft.php?soft=ET
Publié le 16 juillet 2015
